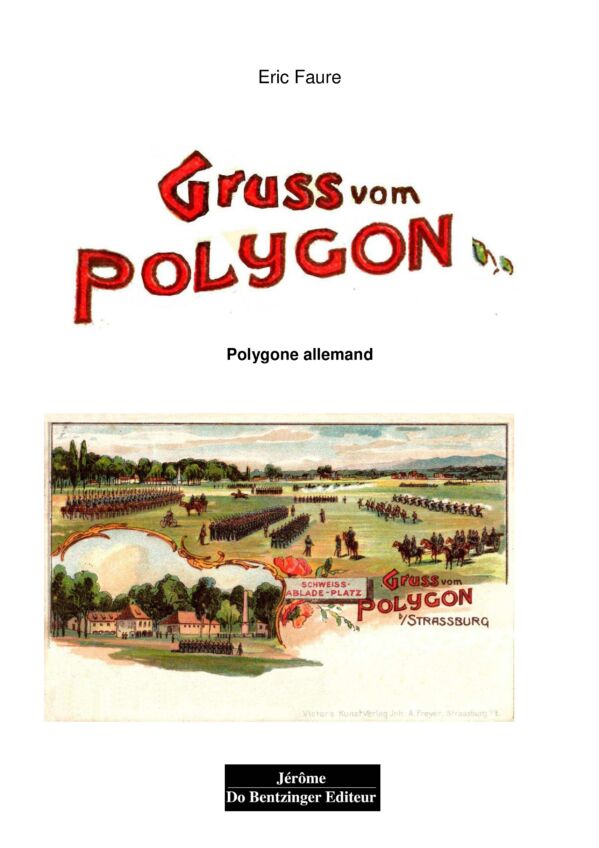

« Des caravanes aux pavillons » se classe dans la catégorie des Beaux Livres. Néanmoins, il ne se résume pas à son visuel. Lutter contre les préjugés, et ne pas oublier les habitants : le Polygone use de sa voix et en fait une œuvre politique engagée. D’autant que la transformation du terrain, présentée dans l’ouvrage, était déjà intervenue après plus de 30 ans d’occupation des lieux. Il s’agit donc de ne pas répéter les mêmes erreurs. Sa vocation est de rappeler au bon souvenir de l’Eurométropole un quartier mis de côté depuis trop longtemps. Pour que trente années d’oubli supplémentaires ne viennent pas fragiliser un peu plus les familles de la rue de l’Aéropostale. Pour que les problèmes structurels soient enfin réglés en comptant sur la tradition humaniste de Strasbourg.
Mais le livre existe aussi pour que le quartier s’ouvre, que des artistes aient envie d’y venir, que le vocabulaire autour de ses habitants évolue. Nous souhaitons combattre les préjugés. Il faut que les gens du Polygone puissent faire la paix avec leur vie d’avant, et s’approprier leur nouvel environnement.
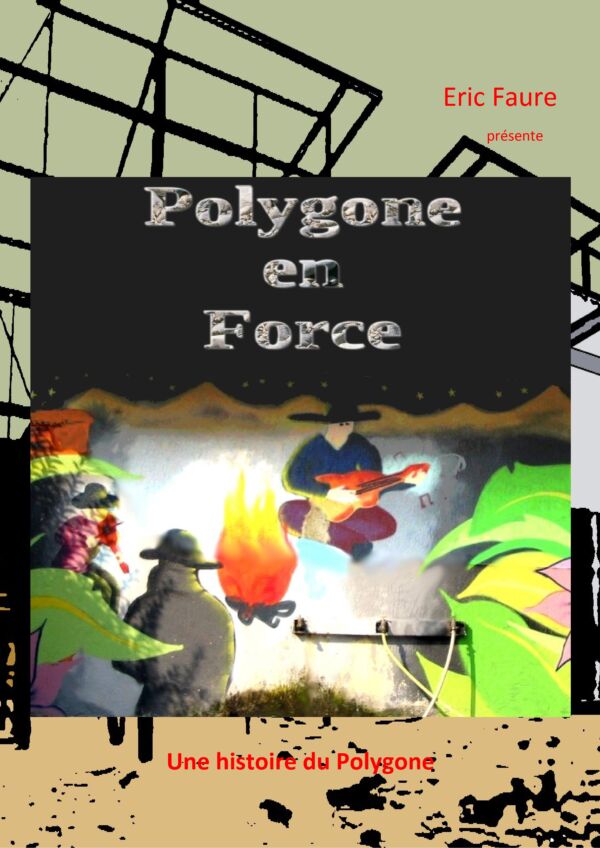
Ce livre s’est imposé à l’auteur dans l’urgence.
Les bouleversements urbains de ces dix dernières années se sont chargés d’effacer progressivement toute trace du passé et aucun habitant du Polygone n’a pu faire, à ce jour, le deuil d’un univers définitivement rasé par les engins de chantier. Ce livre se veut donc un premier témoignage de ce monde disparu, en appelant d’autres, afin que cette histoire strasbourgeoise
prenne toute sa place dans le patrimoine alsacien.
En effet, plusieurs rénovations urbaines de taille ont reconfiguré totalement un quartier entier, événement majeur dans l’histoire contemporaine de Strasbourg. Le Polygone dépasse son image aéronautique et militaire pour devenir un vrai quartier strasbourgeois riche d’une histoire humaine originale et unique.
Raconter l’histoire moderne du Polygone, c’est s’ affranchir de tout apparat architectural, puisque inexistant, pour se concentrer sur l’aventure humaine et urbaine. Cette aventure prend naissance dès les années trente du côté du terrain des Canonniers et va s’étendre après la guerre pour évoluer au fil des décennies. Cité d’urgence, cité provisoire, quartier défavorisé, selon les terminologies admises dans le langage administratif, le Polygone est avant tout un quartier ouvrier. Mais pas seulement. Le lecteur découvre au fil des pages de ce livre toute la complexité des installations familiales qui se sont succédées en un demi siècle. Il découvre, à travers ces installations, l’existence d’une population méconnue et souvent rejetée : les Gens du voyage. Cette population du Polygone, à l’origine composée d’Alsaciens à la rue puis de réfugiés d’Algérie, s’est modifiée petit à petit avec l’arrivée de familles de Yéniches, de Manouches et de Gitans espagnols. Il y a autant d’histoires du Polygone qu’il y a d’histoires familiales et tenter de dégager un destin commun est un des paris de ce livre.
La forme de ce livre a autant de sens que le fond. Dire l’histoire de ce quartier équivaut à mettre ce livre sur la place publique. Et son auteur au centre des regards. Il fut donc primordial que cette histoire puisse être accessible à tous et d’abord aux habitants eux-mêmes. La présence de dessins s’appuyant sur des scènes réelles du Polygone permet de détourner les interdits culturels qui peuvent prévaloir à la diffusion de telle ou telle photo et rend l’ouvrage en tout ou partie accessible à tous. La présence nommée des habitants (quand elle est possible) est une façon d’inscrire les familles dans cette histoire. Avec le risque assumé de quelques omissions ! Élargir cette étude aux persécutions ainsi qu’à certains éléments culturels des Voyageurs sédentarisés, comme la religion, l’école ou la musique nous semble couler de source et est en cohérence avec l’objet premier de ce livre.